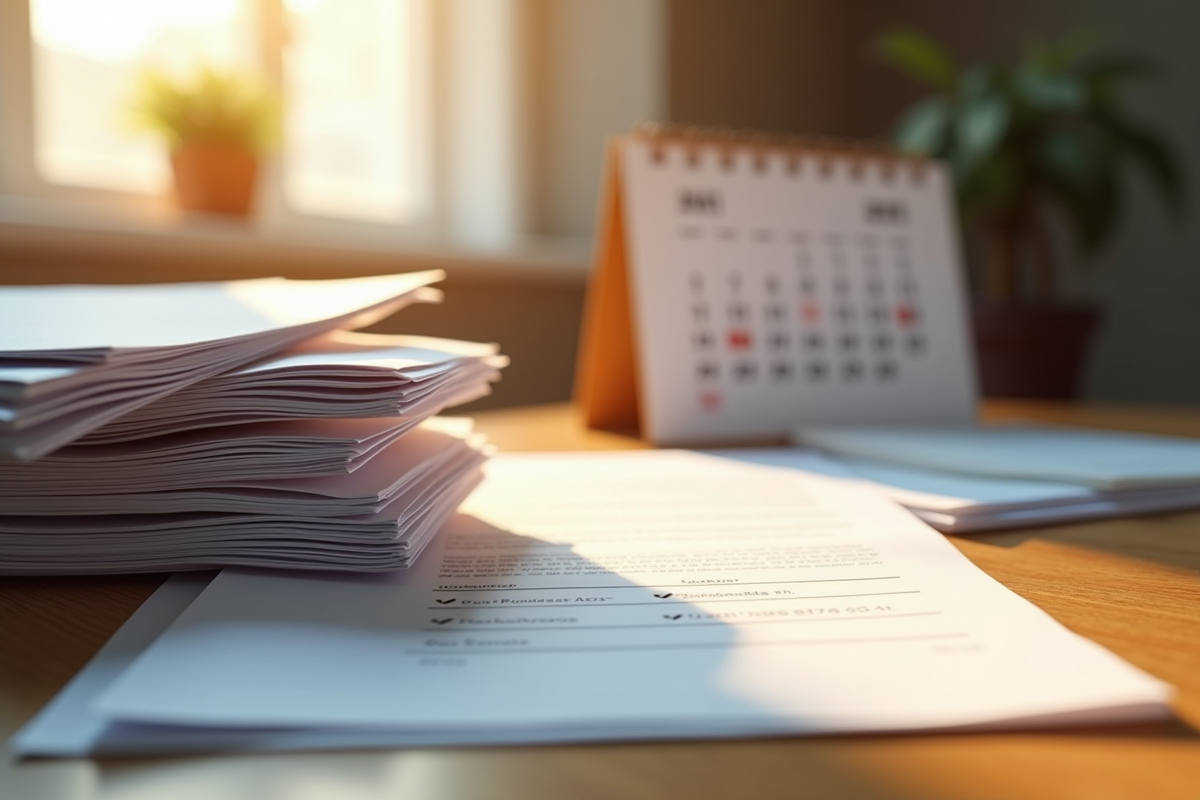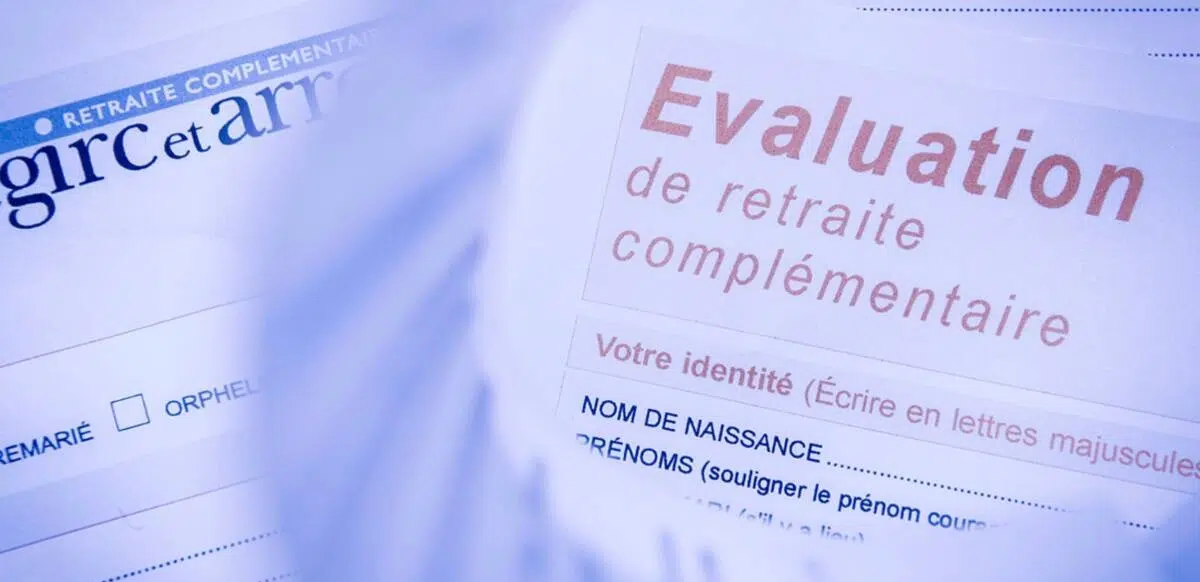Une dette ne s’évapore pas subitement au bout de trois ans. Les règles varient selon la nature de la dette, l’identité du créancier et les circonstances précises. Certaines dettes profitent d’un délai raccourci, d’autres s’étirent dans le temps à cause de textes particuliers ou dérogations.
Un simple geste relance tout : le créancier qui bouge, le débiteur qui reconnaît le montant dû, une action en justice… et voilà l’horloge remise à zéro. Le régime n’est pas le même pour un particulier, un professionnel ou l’administration fiscale. Chacun avance ses propres cartes.
Comprendre la prescription des dettes : ce que dit la loi
La prescription fixe le temps dont dispose un créancier pour réclamer son dû devant le juge. Ce principe, pilier du droit civil, évite au débiteur d’être poursuivi à vie. Mais derrière cette règle générale, les détails font toute la différence : texte de loi, type de dette, jurisprudence.
Pour la plupart des dettes issues d’un contrat civil, le délai de référence reste cinq ans, conformément à l’article 2224 du code civil. Idem pour les litiges commerciaux entre professionnels ou envers un particulier : cinq ans, selon l’article L. 110-4 du code de commerce. Ce délai s’impose, sauf exceptions expressément prévues.
D’autres créances échappent à cette règle. Ainsi, une dette de consommation tombe sous le coup d’une prescription plus rapide : deux ans, selon l’article L. 218-2 du code de la consommation. Le crédit à la consommation subit la forclusion : ici, deux ans suffisent pour rendre une action en justice définitivement irrecevable. Les dettes locatives, elles, sont régies par la loi Alur, qui impose trois ans. Côté fichage FICP, la loi Lagarde bloque la durée à dix ans.
Voici les principaux délais à retenir :
- Créance civile ou commerciale : 5 ans
- Dette de consommation, crédit à la consommation : 2 ans
- Dette locative (loi Alur) : 3 ans
Pour réclamer un paiement, la créance doit être incontestable, chiffrée, exigible et non atteinte par la prescription. Le débiteur reste concerné tant que le délai n’est pas dépassé. Mais tout acte, procédure, reconnaissance écrite, peut relancer la machine et faire repartir le compte à rebours.
Que devient une dette après 3 ans d’impayé ?
Bailleurs ou locataires, la question revient sans cesse : au bout de trois ans, la dette a-t-elle encore force de loi ? Pour les loyers impayés ou charges locatives, la réponse s’impose : la loi Alur, article 7-1, place la prescription à trois ans. Au-delà, plus d’action possible devant le tribunal. La dette existe encore moralement, mais la justice ne peut plus rien exiger.
Le même principe s’applique au salaire non versé. L’article L. 3245-1 du code du travail limite aussi à trois ans le recours pour les arriérés. Passé ce seuil, le salarié n’a plus de recours légal : la créance ne peut plus être imposée par un juge.
Attention, le délai n’est pas linéaire. Une mise en demeure, une procédure judiciaire, ou une simple reconnaissance écrite de la dette : chacun de ces gestes remet le délai à zéro. Le créancier dispose alors d’un nouveau délai, identique au précédent, pour agir.
Retenez les règles essentielles :
- Charges locatives ou loyer impayé : prescription de 3 ans
- Salaire impayé : prescription de 3 ans
- Interruption : tout acte interruptif relance un nouveau délai
La prescription offre au débiteur un rempart contre les poursuites sans fin. Elle pousse aussi le créancier à ne pas laisser traîner sa demande. Après trois ans sans aucune démarche, la dette est effacée au regard du droit.
Délais de prescription selon le type de dette : l’essentiel à retenir
Impossible de généraliser : chaque catégorie de créance suit ses propres règles. Un prêt entre particuliers ou une reconnaissance de dette manuscrite ? Cinq ans, dit l’article 2224 du code civil. Pour deux professionnels, même délai, fixé par l’article L. 110-4 du code de commerce.
Les consommateurs profitent d’un calendrier plus serré : une dette née d’une commande ou prestation se prescrit en deux ans (article L. 218-2 du code de la consommation). Les crédits à la consommation n’échappent pas à la rigueur : la forclusion tombe au bout de deux ans, verrouillant toute possibilité d’action en justice. Pour les loyers et charges locatives, la loi Alur impose trois ans, sans exception.
Pour clarifier, voici une synthèse des délais :
- Créance civile : 5 ans
- Créance commerciale : 5 ans
- Dette de consommateur : 2 ans
- Crédit à la consommation : forclusion en 2 ans
- Loyer et charges locatives : 3 ans
- Salaire impayé : 3 ans
- Facture d’abonnement numérique : 1 an
Ce patchwork de délais impose d’être attentif. Le créancier doit surveiller l’horloge et agir dans la fenêtre permise. Le débiteur, lui, peut opposer la prescription, mais il doit l’invoquer explicitement devant le juge. Dans cette partie d’échecs, ce n’est pas le souvenir du litige qui compte, mais la rigueur du calendrier.
Au fond, la prescription n’efface ni la mémoire ni l’amertume, mais elle impose à tous de regarder la montre : agir ou tourner la page, avant que le temps ne tranche pour vous.